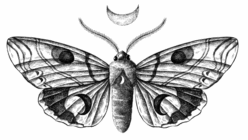Dans notre tradition, La Déesse blanche de Robert Graves est une source d’inspiration poétique et symbolique, non un manuel historique. Nous reconnaissons la puissance évocatrice de son œuvre, tout en gardant à l’esprit ses limites méthodologiques. C’est dans cette optique que nous partageons ici le regard critique de James R. Lewis, extrait de son encyclopédie Witchcraft Today. Ce texte ne cherche pas à invalider la richesse intuitive de Graves, mais à rappeler que son approche relève avant tout du mythe littéraire, plutôt que de la reconstitution historique. Notre voie se dessine à travers le langage des symboles, la sagesse des figures archétypales et la lumière discrète des vérités intérieures.
Par James R. Lewis, extrait de son livre Witchcraft Today An Encyclopedia of Wiccan and Neopagan Traditions. Traduction par Fleur de Sureau
Une source majeure de l’engouement actuel pour une période matriarcale ancienne dans l’histoire est La Déesse blanche de Robert Graves. En effet, la plupart des écrits féministes sur le sujet tentent de soutenir les arguments de Graves. Cependant, les preuves et les raisonnements qu’il utilise dans le livre ne conduisent tout simplement pas aux conclusions qu’il en tire. En réalité, la démarche de Graves relève entièrement d’un plaidoyer particulier : il met en avant les éléments qui favorisent l’idée d’une ancienne religion de la Déesse et tente de minimiser ou d’expliquer les preuves contraires. Par conséquent, bien qu’environ la moitié des informations dans La Déesse blanche soient valables, l’autre moitié est déformée par les efforts de Graves pour faire entrer ces données dans sa théorie préconçue. Ainsi, La Déesse blanche ne peut pas être utilisée pour reconstruire fidèlement les religions anciennes, quelles qu’elles soient.
Objectivement, La Déesse blanche, tout comme les tentatives de Graves pour reconstituer l’histoire du christianisme, est une compilation d’idées proposées par des chercheurs du XIXe et du début du XXe siècle. Ces théories ont été mises à l’épreuve, jugées inadéquates, puis abandonnées. Certains écrivains féministes insinuent (et parfois déclarent explicitement) que ces chercheurs ont rejeté les idées « féministes » parce qu’ils auraient, consciemment ou non, supprimé la véritable importance des femmes dans l’histoire.
Graves a fait de son mieux pour cacher qu’il s’appuyait sur des théories déjà rejetées par la majorité des chercheurs traditionnels. Il est vrai qu’au moment de la rédaction de La Déesse blanche, dans les années 1940, il existait encore une faible possibilité que la culture pré-hellénique en Grèce ait été matriarcale, matrilocale et matrilinéaire, comme Graves l’imaginait. Mais, au cours des trois décennies suivantes, l’archéologie moderne en Méditerranée et les disciplines alliées ont considérablement progressé pour démontrer que la Grèce, entre 2500 et 1500 av. J.-C., était un avant-poste de la culture mésopotamienne. Cette culture partageait les langues, l’architecture, l’économie et, sans doute, les structures sociales des sociétés découvertes à Ugarit et dans d’autres sites autour de la Méditerranée. À la lumière de ces données, il faut supposer que les Grecs avaient le même type de croyances polythéistes que les habitants de ces autres sites, les déesses étaient certes importantes, mais rien n’indique qu’une seule déesse ait été la divinité dominante.
Quiconque connaît les travaux de Georges Dumézil pourrait remarquer que Graves avait raison de percevoir l’existence d’un schéma tripartite dans les mythes des déesses, mais il se trompait en pensant que ce schéma était antérieur aux Indo-Européens. Une déesse triple faisait clairement partie du panthéon indo-européen.
De plus, la théorie selon laquelle une période merveilleuse, matriarcale et agricole en Europe aurait été détruite par d’affreux envahisseurs patriarcaux parlant des langues indo-européennes au cours du deuxième millénaire av. J.-C. est aujourd’hui abandonnée. L’article de Sir Colin Renfrew, The Origins of Indo-European Languages, publié dans le numéro d’octobre 1989 de Scientific American, rapporte que le consensus parmi les préhistoriens est que la langue parlée par les populations ayant répandu l’agriculture en Europe entre 8000 et 2000 av. J.-C. était très probablement indo-européenne. Donc, si les Indo-Européens ont apporté l’agriculture en Europe, les pré-Indo-Européens ne pouvaient pas être des agriculteurs.
Les sorcières pensent généralement, à tort, que La Déesse blanche fournit des preuves indépendantes de l’existence de cultes sorciers « murrayiens » au Moyen Âge. Peu de références à [Margaret] Murray apparaissaient dans la première édition de 1948, qui était beaucoup plus courte. Enfin, il faut noter que Graves n’était pas une autorité indépendante, mais faisait partie du cercle restreint autour de [Gerald B.] Gardner ; Graves était un bon ami d’Idries Shah, qui aurait même été un initié du coven londonien.
Lectures complémentaires :
- Graves, Robert. “An Appointment for Candlemas.” Magazine of Fantasy and Science Fiction (février 1957). L’existence de cette nouvelle montre que Graves faisait partie de la campagne de mythification de Gardner dès 1956.
- The White Goddess: A Historical Grammar of Poetic Myth, 3d ed. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1968 [1948].
- Hutton, Ronald. The Pagan Religions of the Ancient British Isles: Their Nature and Legacy. Cambridge, MA: Blackwell, 1991.
- Renfrew, Colin. “The Origins of Indo-European Languages.” Scientific American (October 1989): 106–114.
NdT : A lire également, un article intéressant : Une réévaluation de la liste des caractères de l’alphabet des Oghams«