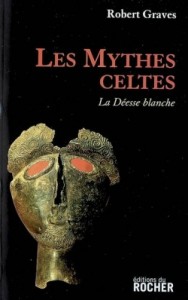F pour FEARN
Extrait du livre « Les mythes celtes, la Déesse Blanche » par Robert Graves.
 Le quatrième arbre est l’aune, l’arbre de Bran. Dans le Combat des Arbres, l’aune combat en première ligne, ce qui est une allusion au fait que la lettre F est l’une des cinq premières consonnes du Beth·Luis-Nion comme du Boibel-Loth. Dans le Chant des Arbres de la Forêt (1), poème irlandais ossianique, il est décrit comme « le plus acharné à la bataille de toutes les essences, le plus chaud des arbres au combat ». Quoique pauvre combustible, comme le saule, le peuplier et le châtaignier, il est prisé des fabricants de charbon de bois d’après lesquels c’est lui qui fournit le meilleur charbon. Son rapport avec le feu est exalté dans le Roman de Brandwen lorsque « Gwern » (l’aune), fils de la sœur de Bran, est brûlé sur un bûcher. Et dans les districts reculés d’Irlande, le crime d’abattre un aune sacré amène, pense-t-on, comme châtiment la destruction par le feu de la maison du fautif. L’aune est aussi à l’épreuve du pouvoir désagrégeant de l’eau. Ses feuilles, légèrement poisseuses, résistent plus longtemps aux pluies d’hiver qu’aucun autre arbre a feuilles caduques et son bois résiste à la destruction indéfiniment, même s’il sert à faire des conduites d’eau ou des pilotis. Le Rialto, à Venise, repose sur des pilotis d’aune, de même que plusieurs cathédrales médiévales. Vitruve, l’architecte romain, mentionne qu’on se servait d’aunes pour établir les fondations des chaussées dans la marche de Ravenne.
Le quatrième arbre est l’aune, l’arbre de Bran. Dans le Combat des Arbres, l’aune combat en première ligne, ce qui est une allusion au fait que la lettre F est l’une des cinq premières consonnes du Beth·Luis-Nion comme du Boibel-Loth. Dans le Chant des Arbres de la Forêt (1), poème irlandais ossianique, il est décrit comme « le plus acharné à la bataille de toutes les essences, le plus chaud des arbres au combat ». Quoique pauvre combustible, comme le saule, le peuplier et le châtaignier, il est prisé des fabricants de charbon de bois d’après lesquels c’est lui qui fournit le meilleur charbon. Son rapport avec le feu est exalté dans le Roman de Brandwen lorsque « Gwern » (l’aune), fils de la sœur de Bran, est brûlé sur un bûcher. Et dans les districts reculés d’Irlande, le crime d’abattre un aune sacré amène, pense-t-on, comme châtiment la destruction par le feu de la maison du fautif. L’aune est aussi à l’épreuve du pouvoir désagrégeant de l’eau. Ses feuilles, légèrement poisseuses, résistent plus longtemps aux pluies d’hiver qu’aucun autre arbre a feuilles caduques et son bois résiste à la destruction indéfiniment, même s’il sert à faire des conduites d’eau ou des pilotis. Le Rialto, à Venise, repose sur des pilotis d’aune, de même que plusieurs cathédrales médiévales. Vitruve, l’architecte romain, mentionne qu’on se servait d’aunes pour établir les fondations des chaussées dans la marche de Ravenne.
 Le rapport entre Bran et l’aune, dans ce sens, est clairement mis en évidence dans le Roman de Brandwm où les porchers (prêtres oraculaires) du roi Matholwch d’Irlande voient une forêt sur l’eau et ne peuvent deviner ce que c’est. Branwen leur dit que c’est la Hotte de Bran le Beni venu le venger. Les vaisseaux sont ancrés au large. Bran s’avance en marchant sur les hauts fonds et fait débarquer ses impedimenta et ses gens; après quoi il jette un pont sur le fleuve Linon, bien que ce dernier dût en être protégé par un charme magique, en se couchant en travers du fleuve et en faisant poser des claies au-dessus de lui. En d’autres termes, à partir d’une jetée, un pont fut construit sur des piles faites d’aune. On disait de Bran : « nulle maison ne peut le contenir ». À l’énigme « qu’est-ce qu’aucune maison ne peut contenir ? » la réponse est simple : « les pilotis sur laquelle elle est construite ! » En effet, les premières maisons européennes furent bâties sur des pilotis d’aune au bord de lacs. « La tête chantante de Bran » fut bien, dans un sens, la tête momifiée d’un roi sacré ; mais dans un autre sens, c’était la tête de l’aune, c’est-à-dire sa frondaison. On fait de jolis sifflets avec les branches vertes de l’aune, c’est la raison pour laquelle, d’après mon ami Ricardo Sicre y Cerda, les garçons de Cerdagne, dans les Pyrénées, scande en catalan une prière traditionnelle :
Le rapport entre Bran et l’aune, dans ce sens, est clairement mis en évidence dans le Roman de Brandwm où les porchers (prêtres oraculaires) du roi Matholwch d’Irlande voient une forêt sur l’eau et ne peuvent deviner ce que c’est. Branwen leur dit que c’est la Hotte de Bran le Beni venu le venger. Les vaisseaux sont ancrés au large. Bran s’avance en marchant sur les hauts fonds et fait débarquer ses impedimenta et ses gens; après quoi il jette un pont sur le fleuve Linon, bien que ce dernier dût en être protégé par un charme magique, en se couchant en travers du fleuve et en faisant poser des claies au-dessus de lui. En d’autres termes, à partir d’une jetée, un pont fut construit sur des piles faites d’aune. On disait de Bran : « nulle maison ne peut le contenir ». À l’énigme « qu’est-ce qu’aucune maison ne peut contenir ? » la réponse est simple : « les pilotis sur laquelle elle est construite ! » En effet, les premières maisons européennes furent bâties sur des pilotis d’aune au bord de lacs. « La tête chantante de Bran » fut bien, dans un sens, la tête momifiée d’un roi sacré ; mais dans un autre sens, c’était la tête de l’aune, c’est-à-dire sa frondaison. On fait de jolis sifflets avec les branches vertes de l’aune, c’est la raison pour laquelle, d’après mon ami Ricardo Sicre y Cerda, les garçons de Cerdagne, dans les Pyrénées, scande en catalan une prière traditionnelle :
Berng, Berng, sors de ta peau :
Je te ferai siffler si joliment.
 Ils la répètent en frappant l’écorce avec un petit bâton de saule pour la détacher du bois. Berng (ou Verng dans le langage de Majorque, de même famille) c’est encore Bran. Les appels à Berng sont faits au profit de la déesse du saule. Le fait de se servir de saule pour frapper, au lieu d’un second morceau d’aune, porte à croire que c’était de tels sifflets que se servaient les sorcières pour évoquer les vents destructeurs, surtout ceux du nord. Mais on peut fabriquer des pipeaux a plusieurs trous de la même façon que les sifflets et, dans ce sens, la tête chantante de Bran peut avoir été un pipeau en aune. À Harlech, où la tette chanta sept années durant, le ruisseau d’un moulin prend sa course au-delà du rocher du Château. C’est l’endroit rêvé pour un bosquet d’aunes sacrés. Il est possible que la légende d’Apollon écorchant vif Marsyas, le joueur de pipeau, soit un souvenir de l’excision de l’écorce de l’aune pour en fabriquer des sifflets.
Ils la répètent en frappant l’écorce avec un petit bâton de saule pour la détacher du bois. Berng (ou Verng dans le langage de Majorque, de même famille) c’est encore Bran. Les appels à Berng sont faits au profit de la déesse du saule. Le fait de se servir de saule pour frapper, au lieu d’un second morceau d’aune, porte à croire que c’était de tels sifflets que se servaient les sorcières pour évoquer les vents destructeurs, surtout ceux du nord. Mais on peut fabriquer des pipeaux a plusieurs trous de la même façon que les sifflets et, dans ce sens, la tête chantante de Bran peut avoir été un pipeau en aune. À Harlech, où la tette chanta sept années durant, le ruisseau d’un moulin prend sa course au-delà du rocher du Château. C’est l’endroit rêvé pour un bosquet d’aunes sacrés. Il est possible que la légende d’Apollon écorchant vif Marsyas, le joueur de pipeau, soit un souvenir de l’excision de l’écorce de l’aune pour en fabriquer des sifflets.
Dans l’ancienne Irlande, on se servait encore d’aune pour faire des seaux à lait et autres récipients de laiterie, d’où son nom poétique, dans le Livre de Balbmate : Comet lachta (« Gardien du lait »). Cette relation entre Bran-Cronos, l’aune, et Rhéa·Io, la vache blanche-Lune ; est d’importance. En Irlande, on appelait lo « Glas Gabhnach », « Celle qui donne du lait encore verte » parce que, tout en n’ayant jamais eu de veau elle produisait des fleuves de lait. Gavida, le nain volant forgeron, l’avait fait sortir furtivement d’Espagne; elle avait fait le tour de l’Irlande en un seul jour, avait été gardée par les sept fils du nain (probablement symboles des sept jours de la semaine) et finit par donner le nom de Botharbo-finné, « Trace de la Vache Blanche », à la Voie Lactée. Selon les Actes de la Grande Académie Bardique, elle aurait été tuée par Guaire à la requête de la femme de Seanchan Torpest, puis, selon l’Histoire d’Irlande de Keating, aurait été vengée en 528 de notre ère quand le roi suprême d’Irlande, Diarmuid, fut exécuté par son fils aîné pour avoir tué une vache sacrée. Le nom de Caer Bran, donné à la colline britannique la plus occidentale, face au cap Land’s end prouve le lien existant entre Bran et l’océan de l’ouest.
La mythologie grecque ou latine mentionne rarement l’aune, sans doute supplanté comme arbre oraculaire par le laurier de Delphes. Mais l’Odyssée et l’Enéide contiennent des références importantes a l’arbre. Dans l’Odyssée, l’aune est le premier nommé des trois arbres de la résurrection (le peuplier blanc et le cyprès étant les deux autres) qui formaient un bois autour de la grotte de Calypso, la fille d’Atlas, dans son île élyséenne d’Ogygie; dans ce bois nichaient et jacassaient les corbeaux de mer (consacrés à Bran en Bretagne), les faucons et les mouettes. Ceci explique la version, donnée par Virgile, de la métamorphose des sœurs de Phaéton, le héros solaire : tandis qu’elles pleuraient la mort de leur frère, dit-il dans l’Enéide, elles auraient été converties, non en un bosquet de peupliers comme le relatent Euripide et Apollonios de Rhodes, mais en un petit bois d’aune situé sur les rives du Po, et ceci désignaient évidemment une île élyséenne de plus. On fait généralement dériver le mot grec pour aune, clethra, de cleio, « je clos » ou « je renferme ». L’explication semble consister dans le fait que les fourrés d’aunes enfermèrent le héros dans l’île oraculaire en poussant autour de sa tombe. Les îles oraculaires semblent avoir été originellement des îles de fleuves et non des îles océaniques.
L’aune était bien connu, et l’est encore, pour produire trois belles teintures : rouge par son écorce, verte par ses inflorescences et brune par ses rameaux. Elles symbolisent le feu, l’eau et la terre. Dans le Glossaire de Cormas (Xème sicle) rédigé en termes désuets, l’aune est dénommé ro-eim, Déduire que les « héros tachés de cramoisi » des Triades galloises, qui étaient des rois sacres, avaient un rapport avec le culte de l’aune de Bran.
Une raison de la sainteté de l’aune est que, lorsqu’il est abattu, son bois, d’abord blanc, semble saigner rouge comme un être humain. Dans le folklore britannique, la teinture verte est associée aux vêtements des fées : si l’on peut voir en ces dernières les survivantes des tribus primitives dépossédées et forcées de se réfugier sur les hauteurs et dans les bois, le vert des vêtements peut s’expliquer comme un camouflage : les forestiers et les brigands l’adoptèrent au moyen âge. L’usage de l’aune est très ancien. Mais surtout il est l’arbre du feu, du pouvoir du feu de libérer la terre de l’eau; et la branche d’aune qui fit reconnaître Bran dans le Câd Goddeu est un symbole de résurrection (ses rameaux sont disposés selon une spirale). Ce symbole de la spirale est antédiluvien : les plus anciens sanctuaires sumériens étaient des »maisons des esprits », comme celles de l’Ouganda, et étaient entourés de piliers spiraliformes.
Le quatrième mois s’étend du 18 mars, époque des premiers chatons de l’aune, au 14 avril et marque l’assèchement des inondations hivernales par le soleil printanier. Il contient l’équinoxe du printemps à partir duquel les jours commencent à devenir plus longs que les nuits et le soleil à devenir adulte. De même que l’on peut dire poétiquement que les frênes sont les rames et la quille du coracle qui transporte l’esprit de l’Année à travers les inondations jusqu’à la terre sèche, on peut également dire que les aunes sont les pilotis qui maintiennent la maison hors de l’atteinte des inondations de l’hiver. Fearn (Bran) apparaît dans la mythologie grecque sous l’aspect du roi Phoronee, législateur du Péloponnèse. Il était honoré comme un héros a Argos qu’il aurait, dit·-on, fondée. Hellanicus de Lesbos, un savant contemporain d’Hérodote, en fait le père de Pelasgus, Iassus et Agénor qui se partagèrent son royaume après sa mort : en d’autres termes, l’origine de son culte à Argos se perdait donc dans la nuit des temps. Pausanias, qui vint a Argos pour s’informer, écrit que Phoronée était le mari de Cerdo (la Déesse Blanche en tant que muse) et que le dieu-fleuve Inachus l’avait fait concevoir par la nymphe Melia (frêne). Puisque l’aune succède au frêne dans le calendrier des arbres, et puisque les aunes poussent au bord des eaux, le pedigree est acceptable. Pausanias confirme l’identification de Phoronée à Fearn en semblant laisser de côté la légende de Prométhée et en faisant de Phoronée l’inventeur du feu. D’âpres Hyginus, le nom de sa mère aurait été Argéia (« d’un blanc éblouissant »), encore la Déesse Blanche. Ainsi Phoronée, comme Bran et les autres rois sacrés, était né de, marié à, et finalement enseveli par la Déesse Blanche : son fossoyeur était la déesse de la mort Héra Argeia à laquelle, dit-on, il aurait le premier offert des sacrifices. Phoronée devint alors le dieu Fearineus, le dieu du printemps auquel on offrait des sacrifices annuels sur le mont Cronien a Olympie à l’équinoxe du printemps (2). Sa tête chantante rappelle celle d’Orphée dont le nom est peut-être une abréviation d’Orphruoeis, « Poussant sur la rive du fleuve », c’est-à-dire « aune ».
En certains pays méditerranéens, on semble avoir utilisé le cornouiller à la place de l’aune. Son nom latin cornus vient de cornix, « corneille ». Celle-ci était consacrée à Saturne, ou Bran, et dévore les « rouges cerises » du cornouiller comme le faisaient aussi les pourceaux de Circé, d’après Homère. Ovide associait ces « fruits » aux glands comestibles comme nourriture des humains pendant l’âge de Saturne. Aussi bien que l’aune, l’arbuste fournit une teinture rouge. On le tenait pour sacrer à Rome où le point de chute du javelot en bois de cornouiller de Romulus avait déterminé l’endroit où la cité devait être construite. Le fait qu’il soit rattaché à ce mois est qu’il est en fleurs, blanches, au milieu de mars.
____________________________________
(1) On peut le trouver, dans la traduction anglaise de Standish O Grady, au milieu du Recueil de poèmes des Gaéls de E. M. Hull. Dans le Dartmoor, il en existe une version charmante, quoi qu’émasculée. Elle énumère quels arbres brûler ou non dans des termes équivalents à ceci en français :
Bûches de chêne chaufferont bien ·
Si elles sont vieilles et sèches,
Bûches de pin sentiront bon
Mais étincelles voleront.
Bûches de bouleau brûleront trop vite,
Et celles du châtaignier à peine,
Bûches d’aubépin durent longtemps :
Coupe-les à la chute des feuilles.
Bûches de houx brûleront comme cire,
Tu peux les brûler vertes;
Bûches d’orme sont comme lin couvant
Sans laisser voir de flamme.
Bûches de hêtre pour l’hiver,
Ou bûches d’if aussi bien;
Bûches de sureau vert, c’est un crime
Pour quiconque de les vendre.
Bûches de poirier et bûches de pommier
Embaumeront la pièce;
Bûches de cerisier contre les chenets
Sentent comme la fleur du genet.
Bûches de frêne, lisses et grises,
Brûle-les vertes ou vieilles
Achète tout ce que tu en trouveras sur ton chemin
Au prix de leur poids en or.
(2) Les Athéniens, pourtant, célébraient la fête de Cronos au début de juillet, pendant le mois de Cronion ou Hécatombéion (« Cent Têtes ») appelé aussi à l’origine Nékusion (« le Mois du Cadavre ») par les Crétois et Hyacinthion par les Siciliens pour rappeler Hyacinthe,le double de Cronos. La récolte de l’orge tombe en juillet, si bien qu’à Athènes, Cronos devenait Sabazios, « jean grain d’orge », le premier à apparaître au-dessus du sol à l’équinoxe de printemps; on célébrait joyeusement sa multiple mort à la fête des moissons. Il avait longtemps perdu ses relations avec l’aune bien qu’il partageât encore un temple à Athènes avec Rhea, la Reine de l’Année gardée par un lion, qui était son épouse de la Saint-Jean et à qui le chêne était consacré en Grèce.
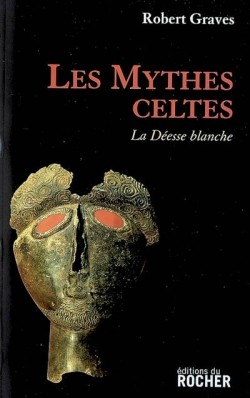 Les branches, mêlées à du lierre, à fruits jaunes, étaient disposées en spirales. Le lierre était employé en l’honneur de Dionysos, le Dionysos d’automne, qu’il faut distinguer du Dionysos du solstice d’hiver, lequel est, en réalité, un Héraclès. Ils s’étaient tatoué un chevreuil sur leurs bras droits au-dessus du coude. Dans leur fureur sacrée, ils mettaient en pièces faons, chevreaux, enfants, voire même des hommes. Le lierre était consacré à Osiris aussi bien qu’à Dionysos. Vigne et lierre se rejoignent à ce tournant de l’année et symbolisent ensemble la résurrection, sans doute parce que ce sont là les deux seuls végétaux du Beth-Luis-Nion qui poussent en spirales. Si la vigne symbolise la résurrection, c’est aussi parce que sa force est transmise par le vin. En Angleterre, les rameaux de lierre ont toujours servi d’enseignes aux débits de vin, d’où le proverbe : « Bon vin se passe de lierre » et l’on brasse encore une bière de lierre, breuvage médiéval hautement toxique, au Trinity College d’Oxford en mémoire d’un étudiant de ce collège assassiné par les hommes de Balliol.
Les branches, mêlées à du lierre, à fruits jaunes, étaient disposées en spirales. Le lierre était employé en l’honneur de Dionysos, le Dionysos d’automne, qu’il faut distinguer du Dionysos du solstice d’hiver, lequel est, en réalité, un Héraclès. Ils s’étaient tatoué un chevreuil sur leurs bras droits au-dessus du coude. Dans leur fureur sacrée, ils mettaient en pièces faons, chevreaux, enfants, voire même des hommes. Le lierre était consacré à Osiris aussi bien qu’à Dionysos. Vigne et lierre se rejoignent à ce tournant de l’année et symbolisent ensemble la résurrection, sans doute parce que ce sont là les deux seuls végétaux du Beth-Luis-Nion qui poussent en spirales. Si la vigne symbolise la résurrection, c’est aussi parce que sa force est transmise par le vin. En Angleterre, les rameaux de lierre ont toujours servi d’enseignes aux débits de vin, d’où le proverbe : « Bon vin se passe de lierre » et l’on brasse encore une bière de lierre, breuvage médiéval hautement toxique, au Trinity College d’Oxford en mémoire d’un étudiant de ce collège assassiné par les hommes de Balliol.


![T pour Tinne [La Déesse Blanche]](https://ignis.le-sidh.org/wp-content/uploads/2020/07/Green-man-king-arthur.jpg)
![H pour Uath [La Déesse Blanche]](https://ignis.le-sidh.org/wp-content/uploads/2020/05/pistil-5125778_1280.jpg)